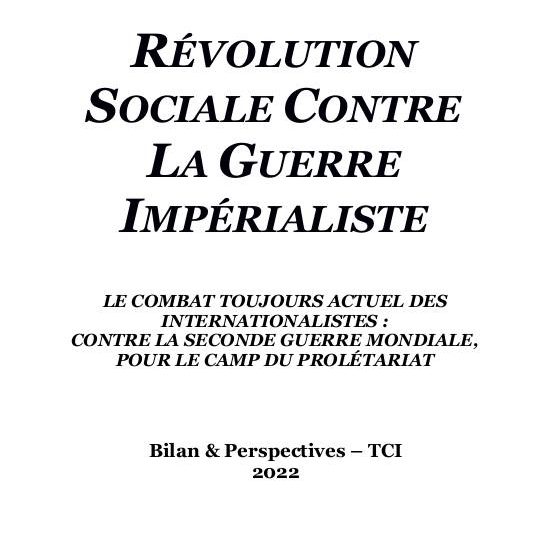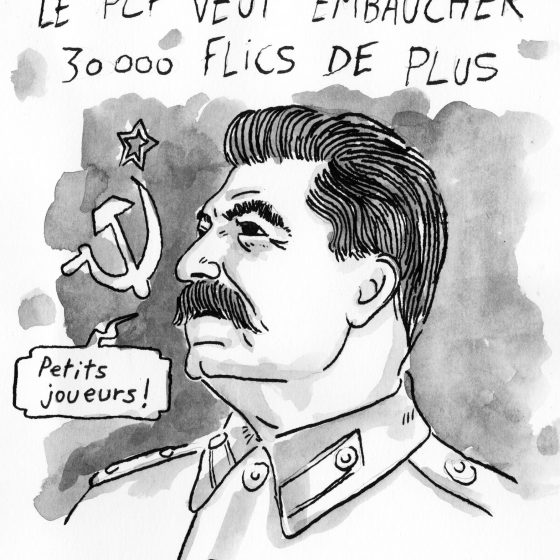La question de la violence policière ne se limite pas à des histoires de matraques, de contrôles au faciès et de lancers de balles de défense. La violence, c’est l’essence même de la police, sa raison d’être, son secret le plus intime.

Et pourtant, la police est présentée comme tout le contraire : dans les discours officiels, c’est elle qui doit nous protéger. Mais disons-le : quand la police nous protège, c’est à la manière dont le chien protège le troupeau du berger. Et si le chien protège le troupeau, c’est que ce troupeau est le troupeau de son maitre, et que seul celui-ci a le droit d’en tondre ou d’en consommer les bêtes.
Mais c’est aussi un troupeau bien particulier, parce qu’il compte quelques moutons enragés. Ce danger est bien plus important aux yeux du berger que celui des prédateurs qui viennent croquer un mouton de temps en temps : et si le maitre crie souvent au loup, c’est pour justifier le nombre de chiens, toujours plus nombreux, dont il estime avoir besoin.
Le capital, bien entendu, est quelque chose d’un peu plus compliqué que le maitre d’un troupeau. C’est avant tout un rapport social, et on a tous un peu de mouton (tour à tour résigné ou enragé) et un peu de chien en nous (et pas du tout de maitre, sauf de la manière la plus illusoire qui soit, quand le berger vient nous flatter à l’encolure en nous murmurant à l’oreille que nous somme comme lui, que nous sommes tous égaux). Mais la police, elle, est une institution : elle a pour but de cristalliser le rapport chien. Elle fait de ses fonctionnaires un concentré de quelque chose de diffus. Pris à part, chaque policier est toujours un mouton, mais dans l’exercice de leur fonction, ils ne sont plus rien d’autre que les chiens de garde du capital.
Dans cette fonction, la violence de la police est la violence de la société toute entière et de ce qui l’ordonne et la commande, le capitalisme. C’est pourquoi la police n’est pas violente seulement quand elle tape, quand elle éborgne, quand elle gaze, quand elle tue : dans ces moments là, elle ne fait que rendre visible quelque chose de permanent. La violence du capitalisme, c’est celle d’une société qui a besoin d’exploiter pour exister ; qui pille les ressources naturelles et épuise les travailleurs, physiquement ou moralement, ou les deux ; qui n’a pas crée le sexisme et le racisme, mais s’en sert autant qu’elle peut pour se maintenir ; qui ne propose rien d’autre que consommer pour travailler et travailler pour consommer. Une telle violence, continue, perpétuelle, devient parfois visible dans le fracas des armes que l’État emploie contre sa population ou pour s’imposer face à un État rival. Il y a la violence extrême de la guerre, la violence à bas bruit de la normalité de la société capitaliste, et, entre les deux, la violence quotidienne de la police.
Pardon à tous les moutons, chiens ou bergers qui se serait sentis offensés par ce texte… Mort aux vaches cependant.